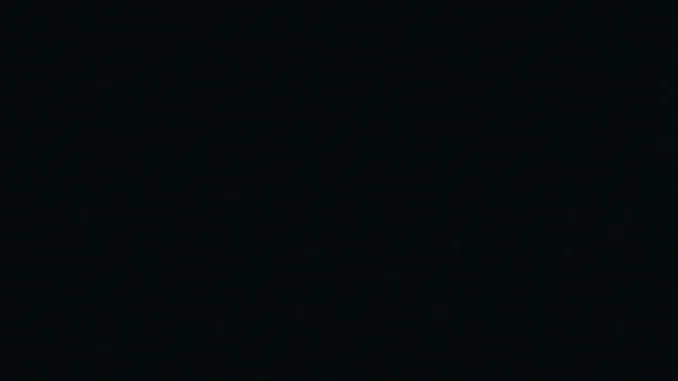
L’action collective des actionnaires minoritaires visant à annuler une résolution constitue un mécanisme juridique fondamental pour protéger leurs intérêts face aux décisions potentiellement préjudiciables prises par les actionnaires majoritaires ou les dirigeants. Ce recours, ancré dans le droit des sociétés, permet aux petits porteurs de contester efficacement certaines décisions adoptées en assemblée générale lorsqu’elles sont susceptibles de léser leurs droits. En examinant les conditions de recevabilité, la procédure et les effets d’une telle action, nous analyserons comment ce dispositif contribue à l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés et à la bonne gouvernance d’entreprise.
Les fondements juridiques de l’action collective des actionnaires minoritaires
L’action collective des actionnaires minoritaires trouve son fondement dans plusieurs textes du droit français des sociétés. L’article L. 225-252 du Code de commerce constitue la pierre angulaire de ce dispositif, en permettant à un ou plusieurs actionnaires d’agir en justice pour obtenir l’annulation d’une décision prise en assemblée générale. Cette disposition s’inscrit dans une logique plus large de protection des droits des minoritaires, consacrée notamment par l’article 1844-10 du Code civil qui prévoit la nullité des actes ou délibérations des sociétés pris en violation des dispositions impératives du droit des sociétés.
Le législateur a progressivement renforcé ce cadre juridique, notamment avec la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui a posé les bases modernes de l’action en nullité. Plus récemment, la loi Pacte du 22 mai 2019 a apporté des modifications visant à faciliter l’exercice de ces actions collectives, en abaissant certains seuils de détention du capital requis pour agir.
L’objectif de ces dispositions est double : d’une part, offrir un contrepoids au pouvoir des actionnaires majoritaires et des dirigeants, et d’autre part, garantir le respect des règles de fonctionnement des sociétés. Cette action s’inscrit ainsi dans une perspective plus large de gouvernance d’entreprise et de protection de l’intérêt social.
Il convient de noter que ce mécanisme n’est pas limité aux sociétés cotées, mais s’applique à l’ensemble des formes sociales, avec des nuances selon le type de société concernée. Ainsi, les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont toutes soumises, dans des modalités parfois différentes, à ce régime d’action en nullité.
Les conditions de recevabilité de l’action en annulation
Pour qu’une action collective visant à annuler une résolution soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunies. Ces prérequis visent à garantir le sérieux de la démarche et à éviter les recours abusifs.
Qualité pour agir
La qualité d’actionnaire minoritaire est évidemment la première condition. Dans les sociétés anonymes, l’action peut être intentée par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social. Ce seuil peut être abaissé pour les sociétés cotées, en fonction de leur capitalisation boursière. Pour les SARL, aucun seuil minimal n’est requis, tout associé pouvant agir individuellement.
Délai de prescription
L’action en nullité doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la date de la délibération contestée. Ce délai est réduit à six mois pour les vices de forme. Il s’agit d’un délai de prescription, susceptible d’interruption ou de suspension selon les règles de droit commun.
Intérêt à agir
Les demandeurs doivent démontrer un intérêt légitime à agir. Cet intérêt s’apprécie au regard du préjudice potentiel que la résolution contestée pourrait leur causer. Il peut s’agir d’une atteinte à leurs droits financiers, à leurs droits politiques au sein de la société, ou plus largement à l’intérêt social.
Motifs de nullité
L’action doit être fondée sur des motifs de nullité reconnus par la loi. Ces motifs peuvent être classés en deux catégories :
- Les nullités de droit : résultant de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés
- Les nullités facultatives : laissées à l’appréciation du juge, notamment en cas d’abus de majorité
Parmi les motifs les plus fréquemment invoqués, on peut citer :
- Le non-respect des règles de convocation ou de tenue de l’assemblée générale
- L’irrégularité du vote (non-respect des droits de vote, fraude)
- La violation des dispositions statutaires
- L’abus de majorité ou de minorité
La jurisprudence a progressivement précisé ces conditions, établissant un équilibre entre la protection des droits des minoritaires et la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement des sociétés.
La procédure de l’action collective en annulation
La mise en œuvre d’une action collective en annulation d’une résolution obéit à une procédure spécifique, encadrée par le Code de commerce et le Code de procédure civile. Cette procédure vise à garantir l’efficacité de l’action tout en préservant les droits de la défense.
Initiation de l’action
L’action est initiée par l’assignation de la société devant le tribunal de commerce du lieu du siège social. Cette assignation doit être signifiée par huissier et contenir l’exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels repose la demande d’annulation. Les demandeurs doivent également justifier de leur qualité d’actionnaires et du respect des conditions de seuil le cas échéant.
Mesures conservatoires
Dans certains cas, les demandeurs peuvent solliciter du juge des référés des mesures conservatoires visant à suspendre l’exécution de la résolution contestée jusqu’au jugement sur le fond. Cette possibilité est particulièrement utile lorsque l’exécution de la décision risque de causer un préjudice irréversible.
Instruction de l’affaire
L’instruction de l’affaire suit les règles classiques de la procédure civile. Les parties échangent des conclusions, dans lesquelles elles développent leurs arguments. Le juge peut ordonner des mesures d’instruction complémentaires, telles que la production de documents ou l’audition de témoins.
Intervention de tiers
D’autres actionnaires peuvent intervenir volontairement à l’instance pour soutenir l’action ou s’y opposer. De même, les dirigeants de la société peuvent être mis en cause personnellement s’il apparaît que leur responsabilité est engagée dans l’adoption de la résolution litigieuse.
Jugement et voies de recours
Le tribunal statue par un jugement motivé, qui peut soit rejeter la demande, soit prononcer l’annulation de la résolution contestée. Ce jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification. L’arrêt d’appel peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Il est à noter que la procédure peut être longue et coûteuse, ce qui constitue souvent un frein à l’exercice de ces actions. C’est pourquoi certains actionnaires préfèrent parfois recourir à des modes alternatifs de résolution des conflits, comme la médiation, avant d’engager une action judiciaire.
Les effets de l’annulation d’une résolution
Lorsqu’une action collective aboutit à l’annulation d’une résolution, les conséquences peuvent être considérables, tant pour la société que pour ses actionnaires et ses partenaires. L’annulation produit des effets rétroactifs et erga omnes, c’est-à-dire à l’égard de tous.
Effets sur la résolution annulée
L’annulation entraîne la disparition rétroactive de la résolution du monde juridique. Elle est réputée n’avoir jamais existé. Cela signifie que tous les actes pris en application de cette résolution sont eux-mêmes nuls, sauf si le juge en décide autrement pour préserver certains droits acquis de bonne foi par des tiers.
Conséquences pour la société
La société doit prendre toutes les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de l’annulation. Cela peut impliquer :
- La convocation d’une nouvelle assemblée générale pour statuer à nouveau sur la question
- La restitution de sommes indûment versées (par exemple en cas d’annulation d’une distribution de dividendes)
- La révision de certaines opérations financières ou stratégiques
Dans certains cas, l’annulation peut avoir des répercussions importantes sur la vie de la société, notamment si elle concerne des décisions structurantes comme une fusion ou une augmentation de capital.
Impact sur les tiers
Les effets de l’annulation à l’égard des tiers sont encadrés par le principe de sécurité juridique. L’article L. 235-12 du Code de commerce prévoit que l’annulation ne peut porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par les tiers. Cette disposition vise à protéger les partenaires de la société qui auraient agi sur la base de la résolution annulée sans avoir connaissance de son irrégularité.
Responsabilité des dirigeants
L’annulation d’une résolution peut engager la responsabilité des dirigeants de la société, notamment s’il est démontré qu’ils ont commis une faute dans la préparation ou l’exécution de la décision annulée. Cette responsabilité peut être recherchée tant par la société elle-même que par les actionnaires à titre individuel.
Régularisation
Dans certains cas, la loi prévoit la possibilité de régulariser la situation après l’annulation. Cette régularisation peut intervenir par le biais d’une nouvelle délibération prise dans les règles, qui aura pour effet de couvrir rétroactivement la nullité prononcée.
L’annulation d’une résolution constitue donc un événement majeur dans la vie d’une société, dont les répercussions peuvent être considérables. C’est pourquoi les tribunaux font preuve de prudence dans l’appréciation des demandes d’annulation, cherchant à concilier la protection des droits des minoritaires avec les impératifs de stabilité et de sécurité juridique nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.
Perspectives et enjeux futurs de l’action collective des actionnaires minoritaires
L’action collective des actionnaires minoritaires pour l’annulation de résolutions s’inscrit dans un contexte plus large d’évolution du droit des sociétés et de la gouvernance d’entreprise. Plusieurs tendances se dégagent, qui pourraient influencer l’avenir de ce mécanisme juridique.
Renforcement de l’activisme actionnarial
On observe une montée en puissance de l’activisme actionnarial, notamment dans les sociétés cotées. Les actionnaires minoritaires, qu’il s’agisse de fonds d’investissement ou de petits porteurs, sont de plus en plus enclins à faire entendre leur voix et à contester les décisions qu’ils jugent contraires à leurs intérêts. Cette tendance pourrait conduire à une augmentation du nombre d’actions en annulation, mais aussi à une évolution des pratiques de gouvernance pour prévenir ces contentieux.
Développement de la soft law
Le développement de la soft law en matière de gouvernance d’entreprise, à travers des codes de bonne conduite ou des recommandations d’autorités de régulation, pourrait influencer l’appréciation des juges dans les actions en annulation. Les tribunaux pourraient être amenés à prendre en compte ces normes non contraignantes pour évaluer la régularité des décisions contestées.
Influence du droit européen
Le droit européen joue un rôle croissant dans l’harmonisation des règles de gouvernance d’entreprise. La directive sur les droits des actionnaires, révisée en 2017, renforce les droits des minoritaires et pourrait conduire à une évolution du cadre juridique français en matière d’action collective.
Enjeux liés à la RSE et à l’ESG
Les questions de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prennent une importance croissante. On peut s’attendre à voir émerger des actions en annulation fondées sur le non-respect de ces critères, notamment dans le cadre de résolutions relatives à la stratégie de l’entreprise.
Digitalisation des assemblées générales
La digitalisation des assemblées générales, accélérée par la crise sanitaire, soulève de nouvelles questions juridiques. Les modalités de vote à distance ou de tenue d’assemblées virtuelles pourraient donner lieu à de nouveaux motifs de contestation et d’annulation de résolutions.
Évolution des seuils et des délais
Le législateur pourrait être amené à revoir les seuils de détention du capital requis pour agir, ainsi que les délais de prescription, afin de trouver un équilibre entre la facilitation de l’accès à l’action en justice et la prévention des recours abusifs.
Développement des modes alternatifs de résolution des conflits
Face aux coûts et à la durée des procédures judiciaires, on pourrait assister à un développement des modes alternatifs de résolution des conflits (médiation, arbitrage) dans le domaine du droit des sociétés. Ces mécanismes pourraient offrir des solutions plus rapides et moins coûteuses pour résoudre les conflits entre actionnaires.
En définitive, l’action collective des actionnaires minoritaires pour l’annulation de résolutions reste un outil juridique puissant, susceptible d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la gouvernance d’entreprise. Son avenir dépendra de la capacité du législateur et des tribunaux à trouver un équilibre entre la protection des droits des minoritaires, la stabilité nécessaire au fonctionnement des sociétés, et les nouvelles exigences en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
